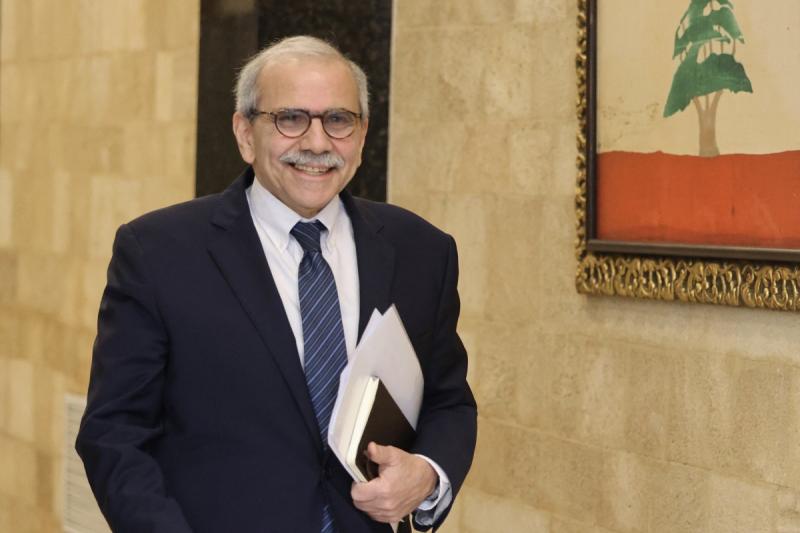Les agriculteurs pensaient qu’"Adam" était une tempête hivernale, mais ils ont vite compris qu’il n’était que le symbole de leurs désillusions face aux changements climatiques. Février, réputé imprévisible selon l’adage populaire, a cette fois-ci trahi les attentes : les précipitations ont été bien en dessous des prévisions.
Un déficit hydrique alarmant
Les chiffres confirment cette sécheresse inhabituelle. Dans la région de Tel Amara, dans la plaine de la Békaa, le cumul pluviométrique au 25 février 2025 n’a pas dépassé 200 mm, contre 600 mm à la même période l’an dernier. Le niveau moyen annuel s’élève pourtant à 470 mm, ce qui signifie un déficit de 42 % par rapport à la normale.
Des pertes colossales pour les agriculteurs
Une telle baisse des précipitations en plein cœur de l’hiver est loin d’être un détail pour le secteur agricole. Si certains agriculteurs ironisent en parlant d’un complot entre la nature et les autorités pour les ruiner, ils n’en mesurent pas moins l’ampleur du désastre. "Ce qui s’est passé et ce qui va suivre relèvent du châtiment", avertit Ibrahim Tarshishi, président de l’Association des agriculteurs de la Békaa.
Les faibles précipitations, conjuguées aux températures nocturnes inférieures à -5°C, entravent la croissance des cultures d’hiver et appauvrissent les nappes phréatiques. "Les puits artésiens, habituellement utilisés pour l’irrigation, ne se sont pas remplis cette année, et les forages plus récents n’atteignent que quelques centaines de mètres cubes d’eau", précise Tarshishi. Résultat : une flambée des coûts de production, une réduction des surfaces cultivées et, inévitablement, une hausse des prix. Dans un contexte de pouvoir d’achat en berne, d’exportations paralysées et de concurrence accrue avec les produits importés, légaux ou de contrebande depuis la Turquie et la Syrie, les agriculteurs libanais risquent d’essuyer des pertes financières considérables.
Des promesses de compensation sans lendemain
Chaque année, les agriculteurs affrontent ces cycles de sécheresse et d’intempéries, et chaque année, les mêmes promesses de soutien restent lettre morte. "Depuis trente ans, nous entendons parler de plans pour faire face aux changements climatiques", déplore Imran Fakhri, membre du Conseil économique, social et environnemental. "Les délégations officielles et internationales viennent constater les dégâts, prennent des photos, font des promesses... mais rien ne change sur le terrain".
Faute de financements, les mesures d’adaptation – telles que la diversification des cultures et la relocalisation des exploitations dans des zones plus adaptées – restent à l’état de projet. En attendant, les terres cultivées se réduisent comme peau de chagrin, forçant de nombreux agriculteurs à abandonner leur métier. Pour ne rien arranger, "les compensations promises après la grande tempête de 2020 n’ont toujours pas été versées par l’Autorité supérieure de secours", rappelle Fakhri.
Des solutions à portée de main, mais une volonté politique absente
Pour Antoine Howayek, président de l’Association des agriculteurs libanais, le problème du changement climatique au Liban repose sur deux principaux facteurs :
- L’augmentation des températures, avec une hausse moyenne de 2,5°C par rapport aux années 1950.
- La diminution des précipitations, combinée à une consommation excessive d’eau, qui assèche les sources et appauvrit les nappes phréatiques.
Aujourd’hui, puiser de l’eau dans la Békaa nécessite de creuser jusqu’à 200 mètres, contre quelques mètres seulement il y a un demi-siècle. Pourtant, des solutions existent. "Plutôt que de gaspiller l’eau de surface en la rejetant directement en mer, il faudrait creuser des puits dits ‘descendants’ le long des cours d’eau pour recharger les nappes phréatiques", explique Howayek. Une approche bien plus efficace et moins coûteuse que les barrages, souvent sujets à l’évaporation et au tarissement. "Mais ces solutions ne profitent pas aux décideurs, ce qui rend leur mise en œuvre impossible", regrette-t-il.
IDAL, un soutien devenu dérisoire
Autrefois, la "Société publique pour l’encouragement des investissements" (IDAL) jouait un rôle crucial dans le soutien des exportations agricoles. Avant l’effondrement économique, elle subventionnait jusqu’à 120 000 L.L. par tonne exportée de pommes de terre, agrumes, pommes et autres produits agricoles libanais, permettant ainsi aux agriculteurs de compenser une partie des coûts de production et d’accéder aux marchés internationaux.
Mais avec la dévaluation de la livre libanaise, cette subvention ne représente plus que 2 dollars, contre 60 dollars autrefois. Pour Fakhri, "revaloriser ces aides permettrait aux agriculteurs de mieux résister aux crises et de s’adapter progressivement aux nouvelles conditions climatiques". À cela s’ajoute la nécessité d’investir dans le secteur agricole afin d’aider les producteurs à se tourner vers des cultures mieux adaptées au climat actuel.
La réouverture des marchés d’exportation, un espoir vital
L’une des solutions majeures pour alléger la crise agricole serait de rouvrir les marchés d’exportation, notamment l’Arabie saoudite, fermée aux produits libanais depuis le 27 avril 2022. "Le marché saoudien est crucial pour notre agriculture, tant en termes de volumes que de revenus", souligne Tarshishi. "Il constitue également un passage incontournable pour le transport terrestre vers d’autres pays arabes".
Alors que le président de la République s’apprête à se rendre en Arabie saoudite, les agriculteurs espèrent qu’il mettra cette question à l’ordre du jour et rassurera les autorités saoudiennes quant à la reprise des exportations libanaises. Une telle avancée permettrait non seulement de stimuler le secteur agricole, mais aussi de briser l’isolement économique du pays.
Une crise de gouvernance plutôt qu’une crise hydrique
"Le Liban n’est pas en faillite, il est pillé. Il n’a pas un problème de manque d’eau, mais un problème de mauvaise gestion", assène Howayek. Selon lui, la solution est simple : il suffit d’une volonté politique pour rationaliser la gestion de l’eau et garantir un approvisionnement durable aux agriculteurs. Mais tant que les intérêts privés priment sur l’intérêt général, l’agriculture libanaise continuera de s’enfoncer dans la crise.
 Politique
Politique