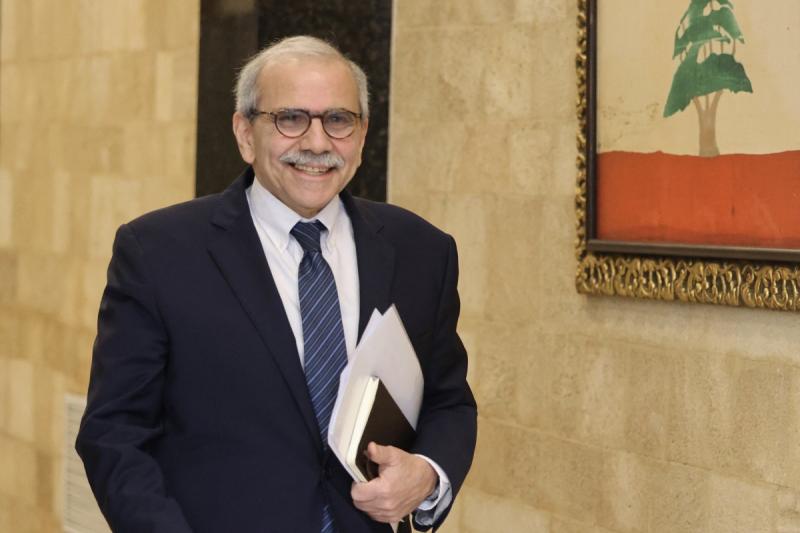C’est une première que deux secrétaires généraux du Hezbollah soient inhumés ensemble. Le 23 février 2025 restera ainsi une journée historique, marquée par l’enterrement de Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, et de son successeur pour seulement quatre jours, Hachem Safieddine. Ce sera un moment ou les sentiments de fierté, de colère, de tristesse et de ferveur culmineront.
Un cortège funéraire populaire massif est inévitable, marquant la fin d’une attente prolongée depuis l’assassinat de Nasrallah le 27 septembre 2025. Figure charismatique et leader historique par excellence, il laisse derrière lui un héritage politique et militaire controversé.
Le Hezbollah présente ces funérailles comme un plébiscite en faveur de son arsenal. Or, le véritable référendum se déroule dans les urnes et au Parlement, où les députés reflètent la diversité politique et les différentes composantes du pays. Ces obsèques ne peuvent se limiter à un adieu solennel ; elles s’accompagnent nécessairement d’un discours projetant l’avenir du Hezbollah, alors que s’ouvre une nouvelle ère marquée par quatre années supplémentaires de présidence de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Un moment d’investiture politique
Le Hezbollah cherchera à capitaliser sur l’ampleur de la mobilisation populaire et sur la participation politique locale, régionale et internationale. Cependant, la présence de délégations étrangères de haut niveau semble improbable, le parti étant classé comme organisation terroriste à l’échelle mondiale et en conflit avec une majorité de pays dans le monde.
Mais au-delà des funérailles, quelles échéances cruciales attendent le Hezbollah ? Quel avenir pour la communauté chiite, dont la représentation parlementaire est entièrement verrouillée par le "duo" Hezbollah-Amal, qui détient les 27 sièges alloués à cette composante ?
Le dilemme de la guerre avec Israël
L’un des défis les plus pressants demeure la conclusion de la guerre déclenchée contre Israël depuis le 8 octobre 2023, lorsque le Hezbollah a ouvert le front sud en soutien à Gaza, invoquant l’"unité des fronts" au sein de l’axe de la "résistance". Malgré les raids, assassinats ciblés, destructions et explosions israéliennes, et malgré l’accord de cessez-le-feu négocié par les États-Unis et la France — un accord sans retrait israélien total des territoires libanais et marqué par des prolongations successives de la trêve de 60 jours —, le Hezbollah s’accroche à la doctrine de la "patience stratégique".
Conscient de l’impossibilité d’un affrontement d’égal a égal avec Israël, il s’efforce au mieux d’entraver l’adversaire et de provoquer des déplacements massifs dans le nord israélien. Toutefois, malgré des discours incendiaires et des démonstrations de force occasionnelles — comme la récente mobilisation sur la route de l’aéroport — le Hezbollah s’efforce désormais de faire porter à l’État libanais la responsabilité de l’après- guerre. Il se réfugie derrière ce dernier pour masquer son incapacité à infliger des coups sévères à Israël.
Son secrétaire général adjoint, Naïm Qassem, justifie ainsi l’adhésion du parti à l’accord de cessez-le-feu : "L’État a décidé d’assurer la protection des frontières et d’expulser Israël, c’est une opportunité pour qu’il assume ses responsabilités et prouve sa capacité politique" (27 janvier 2025).
Or, cette rhétorique ne résout pas l’équation fondamentale du conflit : le sort de l’arsenal militaire du Hezbollah. Israël, avec l’appui américain et le consensus international, pose une condition claire : la guerre contre le Liban se poursuivra tant que le Hezbollah conservera des capacités militaires, aussi rudimentaires soient-elles. L’accord de cessez-le-feu et ses annexes soulignent cette exigence.
Le Hezbollah respectera-t-il son engagement en désarmant et en abandonnant la voie des armes au profit du jeu démocratique ? Ou cherchera-t-il à gagner du temps, espérant des changements de circonstances lui permettant de préserver ce qui lui reste de son arsenal, malgré les frappes israéliennes continues ?
Le casse-tête de la reconstruction
Autre défi majeur : la reconstruction du Liban. Avec le temps, il apparaît de plus en plus évident que cette tâche dépasse les capacités du Hezbollah, qui est incapable de la financer seul. Or, pour que les aides internationales affluent et que l’État libanais puisse relancer la reconstruction, deux conditions essentielles doivent être réunies :
1. L’élimination totale de l’arsenal du Hezbollah, car toute reconstruction demeure vaine tant que le spectre de la guerre plane sur le pays.
2. La mise en œuvre de réformes structurelles, garantissant la transparence et évitant le gaspillage, afin d’empêcher une répétition des expériences désastreuses de la reconstruction de 2006 ou des multiples "fonds" et "conseils" opaques du Liban.
Le 15 octobre 2024, Naïm Qassem promettait : "Je réitère la promesse de notre regretté secrétaire général Hassan, que vous retournerez dans vos maisons, que nous reconstruirons, et que vos foyers seront plus beaux qu’avant. Nous avons déjà entamé les préparatifs nécessaires."
Le 16 février 2025, toutefois, il changeait de ton, rejetant la responsabilité sur l’État : "C’est au gouvernement de prendre en charge la reconstruction, d’attirer des dons, d’organiser des conférences ou de solliciter l’aide des pays amis. Nous sommes prêts à coopérer avec l’État, mais la responsabilité première lui incombe."
Un défi existentiel pour la communauté chiite
Le Hezbollah et Amal font face à une interrogation existentielle : comment assurer une égalité citoyenne avec les autres communautés libanaises après des décennies de domination politique et militaire ?
La communauté chiite perçoit comme une menace la remise en question des acquis obtenus sous l’ère du « Chiisme politique" — né d’une marginalisation perçue comme historique, puis maintien d’un "excédent de puissance" par le biais des armes, contrôle des décisions politiques, intégration dans le système financier et économique, et influence dans les institutions de l’État.
Une vague de frustration, similaire à celle ayant touché certaines franges chrétiennes sous la tutelle syro-libanaise des années 1990, semble émerger. Les slogans scandés dans la rue et sur les réseaux sociaux, tels que "Chiite, Chiite, Chiite" ou encore “ Oh Zahra, Oh Hussein, les chiites ont pris le Liban", reflètent ce malaise communautaire et traduisent une peur latente d’un changement du rapport de force.
Comment, dès lors, habituer la base du Hezbollah à un vivre-ensemble fondé sur l’égalité en droits et devoirs sous l’autorité de l’État de droit ?
Vers une remise en question du système libanais ?
Cette crise ouvre une fenêtre de réflexion sur la nécessité d’une refonte du système politique libanais. Il est temps de sortir du cycle de guerres entrecoupées de paix éphémères et d’instaurer un modèle garantissant la stabilité, la prospérité et, surtout, un sentiment de sécurité et d’égalité entre toutes les composantes du pays.
Les Libanais oseront-ils dépasser le folklore du "vivre-ensemble" et poser les vraies questions ? Se donneront-ils les moyens d’instaurer un État véritablement fondé sur les institutions, la citoyenneté et l’État de droit ?
 Politique
Politique