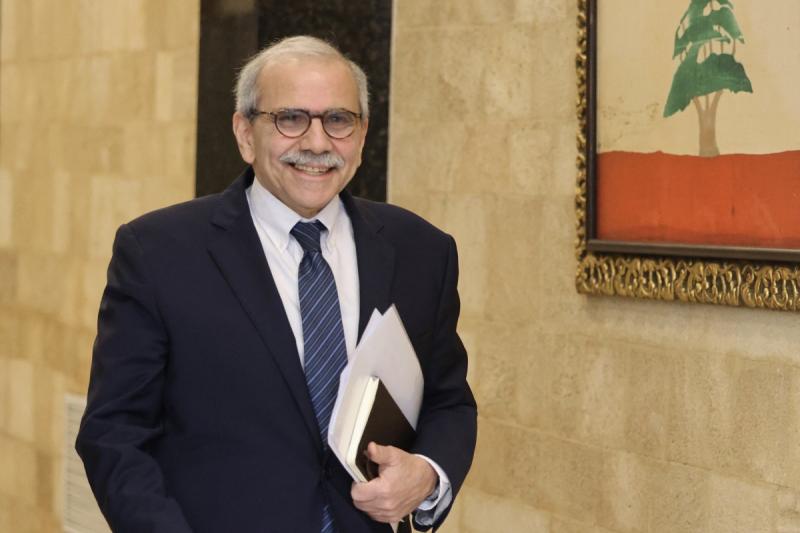Lorsque toutes les factions politiques libanaises ont unanimement déclaré, dans la foulée de l’élection présidentielle et de la formation du gouvernement, qu’une nouvelle phase s’ouvrait au Liban, elles ont toutefois échoué à s’entendre sur la nature et la portée de ce « nouveau départ ». Pour certains, il s’agissait d’un véritable tournant — politique, militaire, économique, financier, social, mais aussi en termes de gouvernance et de mentalités. D’autres, en revanche, y ont vu un changement partiel et sélectif, préservant certains aspects stratégiques, territoriaux et souverains — en particulier la question des armes du Hezbollah, la notion de « résistance », ou encore l’imposition de normes artificielles comme l’attribution confessionnelle du ministère des Finances.
S’appuyant sur l’engagement de « limiter les armes à l’État », inscrit à la fois dans le discours d’investiture présidentielle et dans la déclaration ministérielle, le Premier ministre Nawaf Salam a marqué un tournant décisif en affirmant que « le dossier des armes du Hezbollah est désormais clos, et que la triade « armée-peuple-résistance » appartient au passé ». Dans le même temps, le duo chiite maintenait son attachement à l’arsenal du parti, en contradiction avec toutes les résolutions libanaises, arabes et internationales appelant à son désarmement.
Certes, ni le président Joseph Aoun ni le Premier ministre n’ont encore évoqué directement l’ancienne « stratégie défensive » telle qu’elle fut proposée il y a vingt ans — un projet longtemps bloqué par le refus du Hezbollah durant sa montée en puissance militaire —, mais une alternative a vu le jour. Le président a en effet introduit l’expression « stratégie de sécurité nationale » dans son discours d’investiture et dans ses déclarations ultérieures, laissant entendre que l’ancienne vision de la stratégie défensive avait été abandonnée, dépassée par les évolutions régionales et par des années de tergiversations et d’évitement de la part du Hezbollah.
Ce qui est certain, c’est que les précédentes séances de dialogue national, présidées par le président de la Chambre Nabih Berri en 2006 et le président Michel Sleiman en 2012, avaient permis à la plupart des forces politiques de présenter des propositions sérieuses sur ce dossier — à l’exception du Hezbollah. Fort de sa puissance militaire, le parti refusait alors de se placer à égalité avec les autres, préférant se maintenir au-dessus de tous.
Ce que le Hezbollah avait refusé au sommet de sa force, il tente désormais de le ressusciter dans une phase de repli relatif, misant sur des formules ambiguës permettant à ses armes de rester en dehors du cadre étatique — un scénario inédit, que ce soit dans les États souverains ou sous occupation. Le parti parie clairement sur des évolutions régionales qu’il croit favorables à son allié iranien, comme l’indiquent certaines déclarations de ses responsables et figures affiliées au régime de Téhéran.
Avant la « guerre d’appui » d’octobre 2023, la confiance du Hezbollah en son arsenal était telle que certains de ses dirigeants affirmaient sans détour que l’armée n’était qu’un « complément à la résistance », et non l’inverse.
Aujourd’hui, les données ont changé. Ce qui pouvait fonctionner lors des dialogues de 2006 et 2012 — malgré leurs limites — n’est plus adapté à la phase actuelle. Si stratégie il doit y avoir, ce sera une stratégie de sécurité nationale, englobant tous les secteurs de l’État. La stratégie défensive n’en serait alors qu’un volet parmi d’autres, puisque la sécurité nationale recouvre des domaines tels que l’économie, la justice, la politique, la diplomatie, la sécurité alimentaire, l’environnement, l’éducation, la culture, et bien sûr, la défense.
Dans ce cadre, il n’est plus question d’accepter une dualité des armes — entre forces officielles et non officielles, ou entre rôles principaux et secondaires. Il serait tout aussi incohérent d’intégrer le Hezbollah dans l’armée via une brigade dédiée ou plusieurs, car le caractère confessionnel de ces unités irait à l’encontre du modèle d’intégration nationale et religieuse actuellement en vigueur dans les corps, brigades, régiments et unités d’intervention.
Il a d’ailleurs toujours été avancé que la triade « armée-peuple-résistance » souffrait d’un déséquilibre structurel : la résistance, par son identité confessionnelle et régionale, se trouve en opposition avec l’armée et le peuple, qui représentent la diversité libanaise. Les fondre ensemble dans une même structure défensive n’a donc jamais été envisageable.
La seule voie réaliste serait de recruter et former certains membres du Hezbollah selon les normes légales et militaires en vigueur — sans porter atteinte à la hiérarchie de l’armée, à sa composition nationale ni à sa doctrine défensive.
Dans les faits, on assiste déjà à un changement multidimensionnel : il se reflète dans le discours officiel, dans la composition et les équilibres du gouvernement, dans la politique étrangère, et même dans le dépassement de l’exigence d’unanimité au sein du Conseil des ministres, où les votes sont désormais permis si nécessaire.
Ce basculement inclura inévitablement les questions de défense nationale, avec pour objectif que seules les forces armées légales soient chargées de la souveraineté, des frontières, des infrastructures publiques et des décisions de guerre — sous l’autorité exclusive du pouvoir politique suprême. C’est précisément ce que signifie l’expression : « monopole des armes par l’État ».
Dans ce nouveau cadre stratégique, toutes les formules contraires à la souveraineté réelle et aux engagements arabes et internationaux du Liban tomberont : de « l’unité des fronts » à « l’axe de la résistance », en passant par « les armes protègent les armes », ou encore le soutien à tel régime, l’ingérence dans les affaires d’autres pays, voire leur hostilité. Quant à la fameuse triade « armée-peuple-résistance », l’État lui a déjà offert un aller simple.
Nombre de chapitres ont été refermés, relégués au passé. Ceux qui reconnaissent cette nouvelle étape doivent pleinement adhérer à toutes les dimensions de la modernisation et de la réforme — à commencer par la stratégie nationale de sécurité et la fin des armes illégales. Il n’y a plus de place pour une acceptation à la carte : on ne peut accepter le changement ici, et le refuser là.
 Politique
Politique