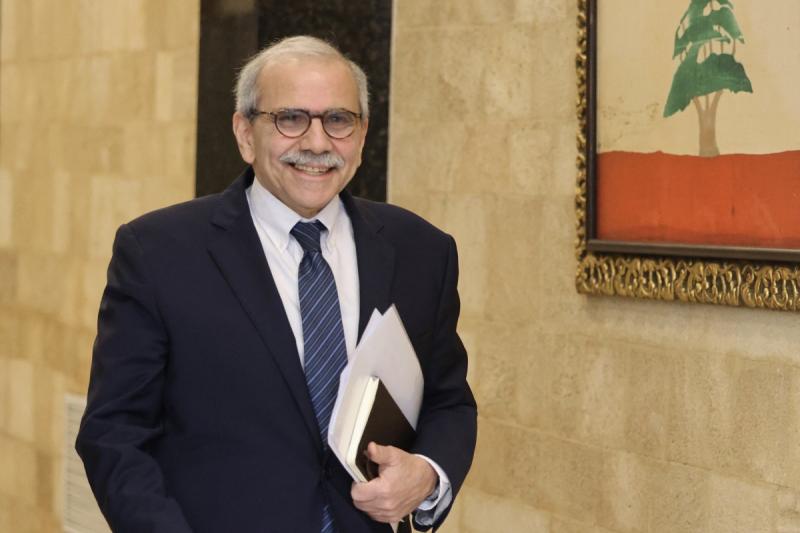D’un trait de plume, le Liban a été, pour la deuxième fois, remis sur la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI). Entre une première inscription en 2000 et la seconde en octobre 2024, vingt-deux années d’élaboration de lois anti-corruption et de lutte contre le blanchiment d’argent ont été "jetées" dans l’océan de la négligence. Un cumul d’indifférence officielle, enveloppé d’intérêts partisans, a enseveli sous des couches d’inaction un arsenal législatif récent, rendant son accès et son application quasi impossibles.
Si l’on sait que le classement du Liban sur la liste grise est dû à son incapacité à mettre en œuvre 46 mesures correctives – dont 21 n’ont jamais été appliquées et 25 partiellement exécutées – il est moins connu que l’un des principaux facteurs de cette relégation est la négligence. C’est ce qui ressort d’une étude approfondie menée par « Sky for Research and Consulting » et « Euro-Med Human Rights Monitor », basée sur des correspondances entre la présidence du Conseil des ministres et les ministères, administrations et syndicats concernés.
Silence radio des autorités concernées
Alors que le GAFI scrutait les failles du dispositif libanais de lutte contre le blanchiment d’argent depuis 2022, les autorités, elles, restaient plongées dans un profond sommeil. Et ce, malgré les multiples alertes leur signalant que la menace de la liste grise était imminente. Dès janvier 2024, la présidence du Conseil des ministres a ainsi adressé des correspondances aux 13 entités concernées, leur demandant d’exécuter des mesures correctives spécifiques, en conformité avec l’évaluation du GAFI.
Le premier courrier, envoyé en février 2024, a été transmis aux ministères des Finances, de la Défense, de la Justice, de l’Intérieur et de l’Économie, ainsi qu’à l’Autorité de contrôle des assurances, à la Commission spéciale d’enquête de la Banque du Liban, à la Direction générale des Forces de sécurité intérieure, aux Douanes, au Parquet de cassation, à la Commission nationale de lutte contre la corruption et aux ordres des avocats de Beyrouth et de Tripoli (Liban-Nord), ainsi qu’à l’Ordre des experts-comptables agréés. Seules cinq entités ont répondu : la Commission de surveillance des assurances, la Commission nationale de lutte contre la corruption, le Parquet de cassation, le ministre de la Justice et l’Ordre des avocats de Beyrouth. Mais leurs réponses sont restées vagues, évoquant des mesures futures, alors que le GAFI exigeait des actions immédiates, selon le directeur d’Euro-Med Human Rights Monitor, Mohammad Al-Mughaybir.
En avril 2024, un deuxième rappel a été envoyé par la direction générale du Conseil des ministres aux entités n’ayant pas répondu. Là encore, silence radio.
Un délai expiré sans réaction
En juillet 2024, la Commission spéciale d’enquête a informé le gouvernement que le délai imparti pour la mise en œuvre des mesures correctives, fixé à la mi-juillet, avait expiré. Elle a exhorté le gouvernement à poursuivre la pression sur les institutions concernées afin d’éviter des conséquences négatives. Ironie du sort, elle a même demandé aux administrations de « prendre la situation au sérieux ».
Face à cette inertie, un dernier rappel a été envoyé par le Conseil des ministres le 20 août 2024, sur recommandation de la Commission spéciale d’enquête. Le GAFI exigeait alors des clarifications avant le 26 août 2024. Résultat : seules cinq institutions ont répondu dans les délais impartis, trois autres après expiration du délai, tandis que quatre entités – le ministère de l’Intérieur, les ordres des avocats de Beyrouth et de Tripoli, ainsi que l’Ordre des experts-comptables – ont choisi de ne pas réagir.
Un placement sur la liste grise inévitable
Le 25 octobre 2024, l’inclusion du Liban sur la liste grise était devenue inévitable. Une commission ministérielle a alors été formée pour assurer le suivi du plan d’action. Pourtant, dans un ultime signe de manque de sérieux, cette commission ne s’est réunie qu’un mois plus tard. Ce n’est que le 19 décembre 2024 qu’un quatrième courrier a été envoyé aux entités concernées, leur demandant deux actions concrètes :
– établir un calendrier précis pour la mise en œuvre des mesures ;
– Désigner un interlocuteur unique pour chaque institution.
À la mi-janvier 2025, aucune réponse n’avait encore été reçue.
Des mesures pourtant loin d’être insurmontables
Les demandes du GAFI n’étaient pourtant pas irréalisables. Par exemple, le ministère de la Justice devait améliorer le registre du commerce et vérifier les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Sa réponse ? Une demande de financement pour la digitalisation du registre, alors que la formation des notaires sur la lutte contre le blanchiment d’argent datait de 2018.
Quant au ministère des Finances, il a mis huit mois pour commenter une simple réforme de la loi sur les procédures fiscales, proposant d’intégrer les modifications dans le budget 2025, en contradiction avec la Constitution et le Code des finances publiques.
Les Douanes, elles, ont attendu neuf mois pour annoncer qu’elles allaient « renforcer leur coopération avec les instances judiciaires ».
Une menace bien plus grave que la liste grise
Aujourd’hui, avec une période de grâce de deux ans pour se conformer aux normes du GAFI, le Liban doit revoir sa stratégie. Car l’enjeu ne se limite pas à la liste grise : c’est l’ensemble du secteur financier libanais qui risque une rupture avec le système financier international, avec des répercussions dramatiques sur l’économie et les droits humains.
Selon « Sky for Research and Consulting » et « Euro-Med Human Rights Monitor », il est impératif que le gouvernement adopte des engagements clairs en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et exerce une pression constante sur les entités concernées pour qu’elles appliquent enfin les réformes nécessaires.
 Politique
Politique