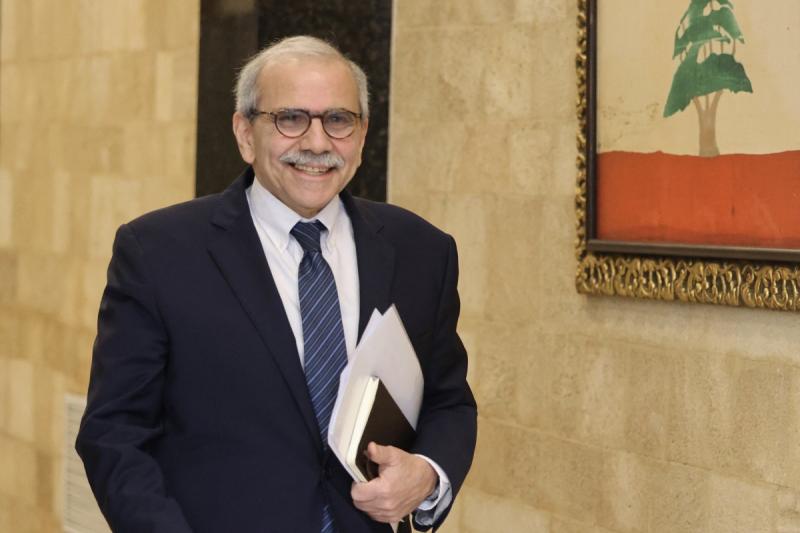À l’approche des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington, prévues fin avril, le gouvernement libanais accélère les démarches pour faire adopter des réformes structurelles cruciales. Déterminés à présenter un front crédible, les ministres des Finances et de l’Économie, ainsi que le gouverneur de la Banque du Liban, comptent se rendre dans la capitale américaine non pas avec de vagues promesses, mais avec de véritables textes législatifs financiers et monétaires — une rupture marquée avec la rhétorique creuse des cinq dernières années. L’objectif final : conclure un accord définitif avec le Fonds monétaire international.
Après avoir approuvé les amendements à la loi sur le secret bancaire et les avoir transmis au Parlement, le ministère des Finances a surpris les observateurs en annonçant dans la foulée le dépôt du projet de loi tant attendu sur la « réforme et réorganisation du secteur bancaire au Liban » au Conseil des ministres. Le texte doit être examiné le 4 avril, avant d’être transmis à son tour au Parlement. Ces deux projets de loi constituent ensemble une pierre angulaire des exigences immédiates du FMI.
Un projet bien connu sous un nouvel habillage
Ce nouveau texte n’est en réalité pas si nouveau. Il s’agit du même projet élaboré par la Commission de contrôle des banques en collaboration avec la Banque du Liban, et présenté au Conseil des ministres le 10 novembre 2023 par l’ancien vice-premier ministre Saadé Chami. Depuis, le texte a été largement étudié par les instances gouvernementales et les experts du FMI, sans qu’un consensus ne soit trouvé ni qu’il ait été officiellement transmis au Parlement.
« Dans sa structure, le projet propose une restructuration des banques sans traiter la question du rétablissement de l’ordre financier ni du sort des dépôts », explique le Dr Karim Daher, professeur de droit fiscal et de finances publiques. Le projet est scindé en deux volets :
Un cadre général, censé rester en vigueur pendant plusieurs années et remplacer les lois 2/67 et 110/91 ;
Un chapitre spécifique, qui prévoit des mesures exceptionnelles pour répondre à la situation actuelle des banques commerciales au Liban.
Des pièges dans le texte
Le projet actuel s’étend sur 33 pages — soit 10 de plus que la version précédente — mais plusieurs zones d’ombre demeurent. L’une des plus controversées concerne la possibilité offerte aux banques de nommer et rémunérer elles-mêmes leurs évaluateurs d’actifs. Cette disposition, selon le Dr Ali Zbib, président de la commission des affaires bancaires au barreau de Beyrouth, constitue un conflit d’intérêts manifeste. « Le risque, explique-t-il, est que l’évaluateur, payé par la banque, gonfle les valeurs d’actifs pour servir ses intérêts. »
Le Dr Zbib identifie deux failles majeures dans le texte :
L’absence de mécanismes de responsabilité : bien que le projet vise la restructuration et non les sanctions pénales, « il est indispensable que les conseils d’administration qui ont pris des décisions désastreuses soient tenus responsables », affirme-t-il.
Le refus de qualifier les banques de défaillantes : ce choix empêche l’application des lois 2/67 et 110/91 qui régissent les établissements bancaires en difficulté.
Légalisation d’un faux récit
En affirmant implicitement que les banques ne sont pas en situation de défaut, le projet renforce, selon Zbib, un récit trompeur : celui d’une crise « systémique ». Cette qualification, dit-il, permet aux banques d’échapper à leurs responsabilités contractuelles et légales, tout en éludant les conséquences de leurs actes passés.
« La vérité juridique, rappelle-t-il, c’est que les banques sont responsables des dépôts, en vertu de contrats explicites — peu importe la manière dont les fonds ont été investis. Les déposants sont des créanciers, non des investisseurs, et ils ne doivent en aucun cas assumer les pertes. »
Les banques libanaises ont, en toute connaissance de cause, placé les fonds des clients dans des produits à haut risque à la Banque du Liban, attirées par des taux d’intérêt anormalement élevés — une décision délibérée, selon Zbib, motivée par les profits générés par les opérations d’ingénierie financière, au détriment des épargnants.
« Ce n’est pas une crise systémique comparable à celle de 2008 aux États-Unis », souligne-t-il. « Certaines banques libanaises, faut-il le rappeler, ont fermé leurs portes pendant 12 jours après le 17 octobre 2019, tout en transférant des milliards de dollars à l’étranger au profit de proches du pouvoir — alors qu’elles imposaient en parallèle un contrôle des capitaux illégal à l’ensemble des déposants. »
Une réforme réelle — pas cosmétique
Le simple vote de deux projets de loi — sur le secret bancaire et la restructuration des banques — ne suffit pas à convaincre la communauté internationale que le Liban est sur la voie du redressement. Ce qui compte, c’est le fond, pas seulement la forme.
Le projet de réforme du secret bancaire, bien qu’il semble solide en apparence, subordonne la levée du secret bancaire à l’application de la loi sur la restructuration bancaire — ce qui en fait une loi conditionnelle. « C’est un piège », alerte Zbib. « Cela crée une loi dont l’exécution dépend d’un autre texte incertain — une configuration propice à l’échec. »
La même critique s’applique au projet de restructuration, truffé de zones d’ombre, dénué de mécanismes de reddition de comptes solides, et incapable de garantir une protection réelle des dépôts. L’usage de termes flous comme « répartition des pertes » alimente encore davantage le scepticisme.
Fuir les réformes - un cercle vicieux
Depuis le début de l’effondrement économique du pays, le processus de réforme tourne en rond, cherchant à éviter toute reddition de comptes et à protéger les acquis des élites. Si la volonté de réformer était sincère, les lois existantes — le Code de la monnaie et du crédit, ainsi que les lois 2/67 et 110/91 — auraient pu être mises en œuvre. Il n’y aurait pas eu besoin de « nouveaux » textes, dont on peut déjà redouter qu’ils finissent enterrés au Parlement, surtout dans un contexte électoral où les discours populistes sur la protection des citoyens se multiplient.
Le Liban risque donc de revenir à la case départ.
En fin de compte, ce qui importe, c’est que les lois adoptées soient rationnelles, dans l’intérêt général, et surtout applicables. Sans cela, il ne s’agira que de réforme de façade — et non d’action concrète.
 Politique
Politique