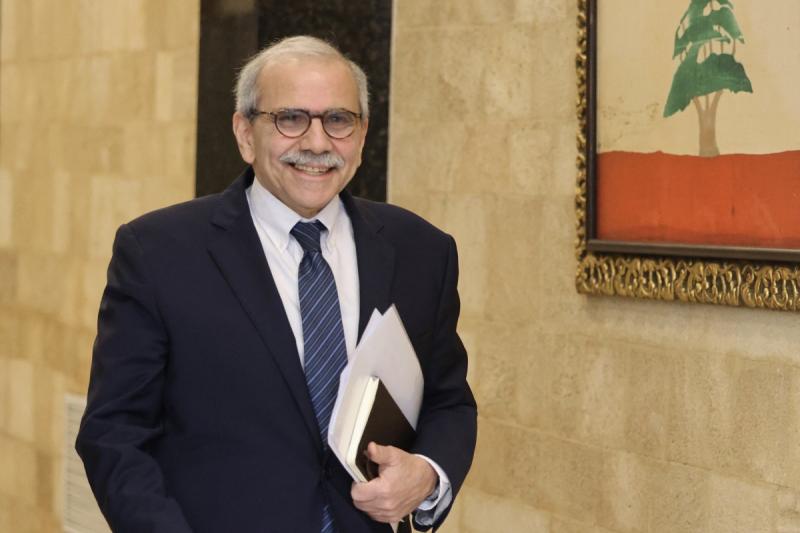Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu traverse actuellement l’une des phases les plus solides de sa carrière politique, ayant remporté deux victoires majeures sur le plan intérieur, renforçant considérablement sa position face à une opposition politique et populaire grandissante.
La première de ces victoires fut l’adoption du budget national — un échec aurait signifié la chute de son gouvernement. La seconde a été l’approbation par la Knesset d’un projet de loi visant à remodeler le comité de sélection des juges. Bien que cette mesure puisse encore faire l’objet de recours judiciaires, elle marque l’aboutissement symbolique de la longue bataille menée par Netanyahu pour restreindre les pouvoirs du pouvoir judiciaire — une campagne lancée depuis plus de deux ans sous l’étiquette de « réforme judiciaire ».
La coalition de droite dirigée par Netanyahu ne dispose que d’une majorité étroite mais stable, avec 67 sièges sur les 120 que compte la Knesset. La survie de son gouvernement repose sur ses alliés d’extrême droite, Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich. Bien que cette alliance soit fragile, elle reste intacte.
Ayant consolidé son emprise sur le pouvoir judiciaire, après avoir fait de même avec l’armée, Netanyahu semble désormais viser d’autres institutions sécuritaires. Son conflit avec le chef du Shin Bet (Shabak), Ronen Bar — qui détiendrait des informations compromettantes sur des affaires de corruption impliquant Netanyahu, dont le scandale dit du « Qatar-gate » — est loin d’être terminé. Il cible également la procureure générale, Gali Baharav-Miara.
Et pourtant, malgré les oppositions internes et externes, rien ne semble freiner l’élan de Netanyahu. Il maîtrise parfaitement l’art d’exploiter les conflits militaires à l’étranger pour mobiliser le soutien intérieur, tout en transformant les affrontements politiques internes en outils de diplomatie internationale et de diversion.
À l’avenir, Netanyahu semble déterminé à poursuivre ses guerres au-delà des frontières d’Israël — que ce soit à Gaza, en Cisjordanie, en Syrie, au Liban ou même au Yémen. Ces fronts extérieurs remplissent un double objectif : consolider son pouvoir et retarder les procédures judiciaires le visant pour corruption, abus de confiance et fraude. Grâce à sa maîtrise politique, son charisme personnel et son expérience, il a réussi à ralentir ces poursuites tout en renforçant sa coalition.
Pendant ce temps, il continue d’agiter la menace existentielle qui pèserait sur Israël, évoquant l’antisémitisme et le spectre d’une guerre sur plusieurs fronts. Il ne cesse de faire référence à sept fronts militaires actifs, dans le but de susciter la sympathie d’un public israélien inquiet, et de détourner l’attention d’une crise économique de plus en plus grave — sans jamais être tenu pour responsable.
De son côté, l’opposition est en plein désarroi. Composée d’un mélange idéologique fragmenté de courants de droite, du centre et d’une gauche affaiblie, elle souffre d’un manque de leadership capable de rivaliser avec Netanyahu. Bien qu’elle dispose de quelques atouts politiques, elle ne peut se permettre d’attendre les prochaines élections prévues en octobre 2026 pour contester son pouvoir.
Certains au sein de l’opposition envisagent désormais d’intensifier les manifestations populaires et la désobéissance civile, en s’appuyant sur le malaise qui couve dans les rangs de l’armée — notamment parmi les réservistes. Ces tensions ont alimenté les craintes, même chez des vétérans de la politique israélienne, d’un chaos intérieur imminent, voire d’une guerre civile. Ironiquement, une telle instabilité pourrait finir par servir Netanyahu en ternissant l’image de l’opposition.
Ces dernières semaines, les voix de l’opposition se sont faites plus pressantes, accusant l’armée et les services de renseignement — y compris le Shin Bet — d’excès de violence, non seulement envers les Palestiniens, mais aussi envers les Israéliens. Ces accusations dressent le portrait d’un Israël glissant vers l’autoritarisme, en contradiction avec son image d’État moderne et démocratique. Les médias israéliens eux aussi ont accru leurs critiques vis-à-vis de la guerre à Gaza, appelant au retour des valeurs démocratiques, à la fin du bain de sang palestinien et à une conduite plus éthique et légale dans les conflits armés.
Mais au milieu de ses incessantes références aux sept fronts militaires, Netanyahu omet délibérément le plus crucial : le front intérieur. Ce champ de bataille domestique, nourri par la polarisation politique et les luttes de pouvoir institutionnelles, représente le défi le plus important à sa gouvernance — et déterminera en fin de compte son avenir.
C’est pourquoi Netanyahu n’a aucun intérêt à rechercher la paix à l’étranger. Bien au contraire, il prospère dans un état de conflit permanent. Son gouvernement bloque toute résolution diplomatique sérieuse à Gaza, préférant une double stratégie : des négociations indirectes sans fin via des médiateurs américains, égyptiens ou qataris d’un côté, et une pression militaire constante, des assassinats ciblés et des efforts de réoccupation de l’autre. Cette approche, portée par le ministre de la Défense Yisrael Katz — un proche de Netanyahu — explique les avancées militaires continues d’Israël et sa progression territoriale graduelle.
Dans le calcul politique de Netanyahu, la guerre n’est pas l’échec de la diplomatie, mais un instrument de survie.
 Politique
Politique