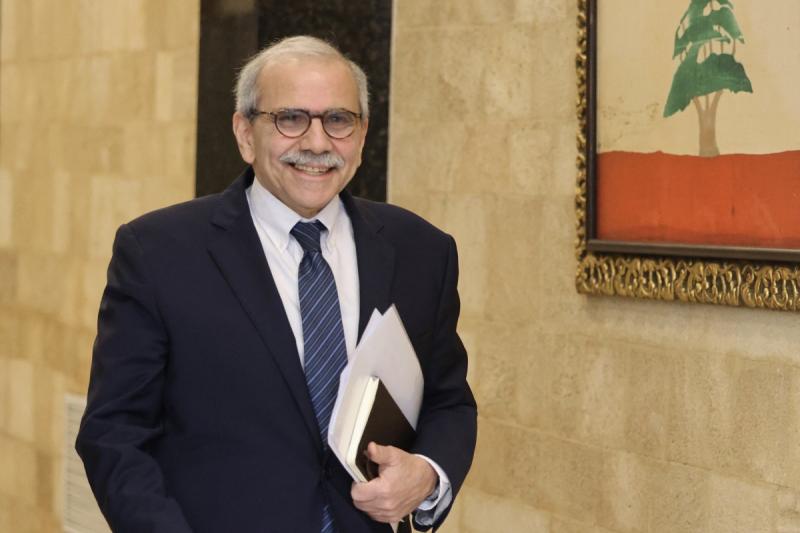Faut-il rappeler que nous sommes à la veille du « jubilé d'or » du déclenchement de la guerre du Liban en 1975 ? Quelques jours seulement nous séparent de cet anniversaire, marquant l'étincelle qui a embrasé le pays pour quinze années de conflit, dont les répercussions perdurent encore aujourd’hui.
Cette guerre n’a pas éclaté en raison d’une lutte pour le pouvoir entre Libanais, ni à cause de tensions confessionnelles ou de divisions sociales, bien que ces questions aient été légitimement soulevées. Son véritable déclencheur fut la question du rapatriement des Palestiniens au Liban. Et aujourd’hui, ce spectre semble ressurgir à la lumière des développements liés à la guerre à Gaza et à ses répercussions sur le Liban.
Tout a commencé avec la guerre de 1967, qui s’est soldée par une défaite arabe qualifiée de « Naksa ». Le conflit a ensuite pris une autre tournure avec la montée en puissance des actions des fedayins palestiniens, notamment au Liban, et la multiplication des initiatives diplomatiques visant à résoudre le conflit israélo-arabe. C'est alors que Henry Kissinger, conseiller à la sécurité nationale sous Richard Nixon en 1969, introduisit la théorie du « peuple excédentaire » au Moyen-Orient.
Kissinger considérait qu’Israël était entouré de quatre pays frontaliers : l’Égypte, la Jordanie, la Syrie et le Liban, et qu’en Palestine, coexistaient deux peuples, israélien et palestinien. Six peuples pour cinq pays, ce qui, selon lui, signifiait qu’un peuple était en trop. La Jordanie fut alors désignée comme « l’option la plus faible » pour servir de patrie de substitution aux Palestiniens. Ce projet déboucha sur les événements sanglants de « Septembre noir » en 1970, qui prirent fin en 1971 avec l’éradication de cette alternative par le roi Hussein, entraînant l’exil de Yasser Arafat (Dirigeant précédent du Fatah et de l’Organisation de libération de la Palestine) et de nombreux dirigeants palestiniens vers le Liban.
Si la théorie du « peuple excédentaire » sembla s’atténuer, le problème du rapatriement, lui, demeura. Devenu secrétaire d’État, Kissinger entreprit en 1973 une tournée dans la région, mais il fut empêché de débarquer à l’aéroport de Beyrouth en raison de la présence des factions palestiniennes armées aux abords de la capitale. Son avion fut détourné vers la base de Riyaq. Il en conclut qu’un pays dont la capitale ne pouvait accueillir un visiteur étranger n’était pas viable et qu’il pouvait donc devenir la nouvelle patrie des Palestiniens.
Cette idée séduisit certains dirigeants palestiniens qui, grâce à l’Accord du Caire de 1969, avaient instauré un État dans l’État, non seulement dans le sud du Liban — surnommé « Fatahland » — mais aussi sur l’ensemble du territoire libanais. C’est dans ce contexte qu’eut lieu l’attaque de l’autobus d'Aïn el-Remmaneh le 13 avril 1975, point de départ de la guerre civile libanaise. Une guerre où les factions palestiniennes s’impliquèrent profondément, tandis que nombreux étaient ceux qui continuaient à la qualifier de « guerre interne ».
Dans les coulisses, des négociations secrètes auraient eu lieu. Il est dit que Dean Brown, envoyé spécial de Kissinger, aurait proposé au président Sleiman Frangié un plan visant à relocaliser les chrétiens du Liban aux États-Unis, avec des navires déjà prêts pour le transport. Frangié refusa l’offre, mais le conflit s’enlisa.
L’intervention syrienne au Liban en 1976 ajouta une nouvelle dimension au conflit. Damas, ayant perçu un rapprochement entre Anwar el-Sadat (Ancien président d'Égypte) et Israël après la conférence de Genève en 1975, tenta de renforcer son influence en regroupant sous son aile l’OLP et le Liban. Ce contexte permit finalement la visite de Sadat en Israël en 1977 et la signature des accords de Camp David.
Face à l’axe « résistance et confrontation » formé par la Syrie, l’OLP et certains régimes arabes, Israël chercha à tirer parti du chaos libanais, conduisant à l’invasion de 1982 sous l’opération « Paix en Galilée ». Ce conflit affaiblit l’OLP, força son exil à Tunis et aboutit à l’accord du 17 mai 1983 entre le Liban et Israël, rapidement annulé en 1984 sous la pression syrienne.
Le Liban crut alors avoir tourné la page du rapatriement forcé. Mais l’histoire prouvait le contraire : le retour de Yasser Arafat à Tripoli (Liban Nord), la guerre des camps entre « Amal » et les factions palestiniennes, et l’affaiblissement du pouvoir libanais sous l'ancien président Amine Gemayel maintinrent la question du rapatriement en suspens.
Avec l’Accord de Taëf en 1989, la guerre prit fin en 1990. Son préambule rejetait explicitement toute forme de rapatriement, de division ou de partition du Liban. Pourtant, lors des négociations de paix de Madrid en 1991, le dossier resurgit, notamment avec le débat sur l’incapacité des territoires palestiniens à absorber les réfugiés. Des projets virent le jour, comme celui d’installer 6 000 familles palestiniennes à Iqlim el-Kharroub (Mont Liban), sous prétexte de leur fournir des moyens de subsistance.
L'ombre du rapatriement plana sur chaque crise ultérieure : les guerres israéliennes contre le Liban en 1993 et 1996, le retrait israélien en 2000, la guerre de 2006, et plus récemment, les conflits à Gaza et au sud du Liban. Aujourd’hui, alors que le projet des deux États semble voué à l’échec, les spéculations vont bon train sur le déplacement des Palestiniens vers la Jordanie et l’Égypte, tandis que le Liban fait face à la pression pour régulariser la situation des réfugiés palestiniens et syriens déjà présents sur son sol.
Des organisations internationales et certains pays allouent des fonds à cette cause, suscitant des craintes quant à une normalisation du rapatriement sous couvert d’intégration sociale et économique. L’ancien président Michel Aoun avait déjà exprimé son refus à l’ONU à deux reprises. Pourtant, le sujet pourrait être remis sur la table à la lumière des derniers développements régionaux.
Certes, la nouvelle administration libanaise bénéficie d’un soutien international et arabe, et elle cherche à stabiliser le pays et à restaurer la confiance. Mais Israël, fort de l’appui politique, militaire et financier des États-Unis, poursuit ses ambitions expansionnistes. La carte du Moyen-Orient se redessine sous nos yeux.
Retour à la case départ ? Ce que les Libanais avaient rejeté le 13 avril 1975 leur sera-t-il imposé aujourd’hui ? Espérons que non.
 Politique
Politique