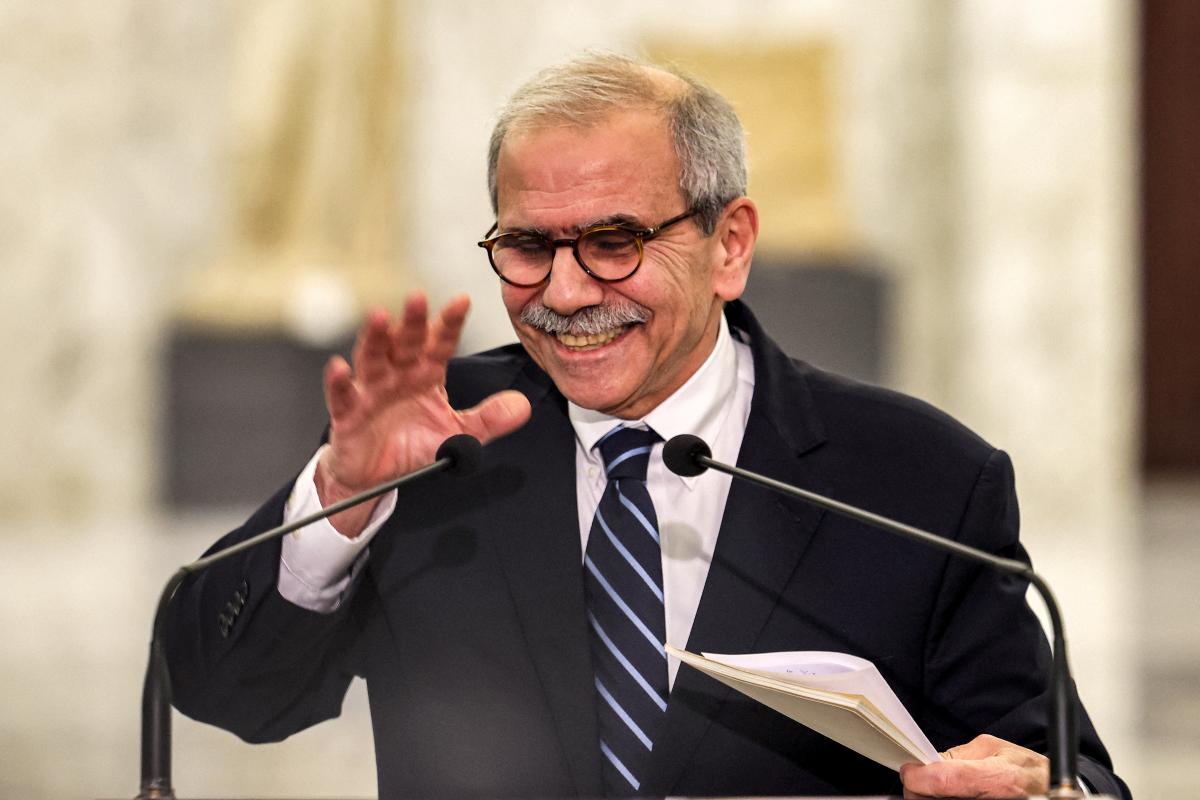Il ne s’agit ni d’une coïncidence ni d’une simple reproduction du passé : tous les présidents de la
République libanaise, depuis les amendements constitutionnels découlant de l’accord de Taëf en
1989, ont dénoncé, après en avoir fait l’expérience, les nombreuses lacunes qui entravent le bon
fonctionnement du pouvoir au Liban.
Le premier d’entre eux, Élias Hraoui, qui avait participé aux réunions de Taëf et fut le deuxième
président élu après l’assassinat de René Moawad, en fit l’amer constat. Quant à ses successeurs –
Émile Lahoud, Michel Sleiman, Michel Aoun – ils n’ont cessé de pointer ces failles, jusqu’à
l’actuel président, Joseph Aoun, qui a évoqué dans son discours d’investiture la nécessité de
développer l’accord de Taëf afin de permettre à l’État de fonctionner pleinement.
L’une des failles majeures, qui a conduit à trois vacuums présidentiels depuis 1989, réside dans
l’absence de délai imposé au Premier ministre désigné Nawaf Salam pour former son
gouvernement. Il peut ainsi prendre tout le temps qu’il juge nécessaire, même si cela dure un an,
comme ce fut le cas avec Tammam Salam. De plus, les gouvernements d’union nationale,
instaurés depuis l’accord de Doha en 2008, ont transformé le Conseil des ministres en un micro-
parlement où chaque camp est à la fois juge et partie. Gare alors à celui qui tenterait de
minimiser le poids de l’une ou l’autre composante politique, confessionnelle ou
communautaire… au risque de déclencher une crise aux conséquences incalculables.
Le contexte actuel de la formation gouvernementale est marqué par les mêmes écueils.
L’optimisme qui a accompagné l’ascension de Nawaf Salam à la présidence du Conseil s’est
rapidement heurté à une série d’obstacles qui ont ralenti la dynamique du début du mandat de
Joseph Aoun. Pourtant, ce dernier avait procédé à des consultations parlementaires en une seule
journée pour désigner Nawaf Salam, et ce dernier avait aussitôt entamé ses propres consultations
non contraignantes. Mais alors que le duo chiite Amal-Hezbollah les avait initialement
boycottées, une rencontre avec Nabih Berry (Le président de la Chambre des députés) a permis
de tourner la page de l’accord brisé qui aurait dû conduire à la nomination de Najib Mikati (le
dernier Premier Ministre), et non de Salam.
Désormais, le Premier ministre désigné tente de concilier les exigences des blocs parlementaires
avec sa propre vision du pouvoir, en prenant en compte la dynamique qui accompagne
généralement le début d’un mandat. Toutefois, il refuse de se laisser dicter ses choix par les
demandes des partis et députés, au risque de prolonger le processus de formation du
gouvernement.
Certes, il reste dans un délai raisonnable pour constituer son équipe, avançant avec prudence sans
pour autant se précipiter. Mais au-delà des apparences, une réalité demeure : les belles
déclarations sur la nécessité de bâtir un État masquent souvent des ambitions claniques et
confessionnelles. La logique tribale, fondée sur des intérêts particuliers et électoralistes, continue
de primer sur l’intérêt général, à l’approche des législatives prévues en mai 2026.
Si Nawaf Salam refuse de céder aux pressions des forces politiques et compose un gouvernement
indépendant, pourra-t-il obtenir la confiance du Parlement ? Devra-t-il alors renoncer et se retirer
? Acceptera-t-il d’être reconduit dans ses fonctions ? Et qui pourrait le remplacer dans un tel
scénario ?
Au-delà de son sort personnel, ce sont les espoirs placés dans ce nouveau mandat présidentiel qui
sont en jeu. Quelle serait alors la position des pays amis et des parrains régionaux du Liban ?
Dans l’histoire contemporaine du Liban, qu’il s’agisse de la période précédant l’indépendance ou
des décennies suivantes jusqu’à la guerre civile de 1975, le pouvoir a toujours été réparti entre
des clans, des confessions et des factions rivales, avec des degrés d’influence variables. Même
sous le mandat du président Fouad Chéhab, qui avait tenté de moderniser l’État et de limiter les
luttes de pouvoir confessionnelles, la logique des appartenances tribales n’a jamais
complètement disparu.
Pendant la guerre civile et jusqu’en 1990, les milices ont pris le relais des anciennes structures,
s’accaparant pouvoir et richesses et façonnant une nouvelle élite politique et sociale, qui a
remplacé en partie l’ancienne classe dirigeante sans pour autant l’éliminer totalement.
Depuis la mise en place de la « Seconde République » issue de l’accord de Taëf, le pays s’est
retrouvé sous l’influence de puissances étrangères – États-Unis, Arabie saoudite, Syrie – qui ont
parrainé et façonné la nouvelle répartition des pouvoirs. Cette période a vu émerger une nouvelle
élite politique, où l’aristocratie financière s’est alliée aux féodalités politiques et religieuses,
intégrant également des anciens chefs de milice issus de la guerre civile.
Et que dire des factions qui, au fil des décennies, se sont systématiquement ralliées à chaque
occupant, tuteur ou puissance dominante ? Ces opportunistes, souvent dépourvus de tout sens
national, n’ont jamais hésité à retourner leur veste selon les vents dominants.
Depuis le retrait des troupes syriennes en 2005, et malgré le maintien de la Force intérimaire des
Nations unies au Sud-Liban, la fragmentation du pays a pris une nouvelle dimension, exacerbée
par les bouleversements du « Printemps arabe ». De nouveaux clivages, religieux et
idéologiques, ont vu le jour, fondés sur l’intolérance, l’exclusion et le repli identitaire.
Aujourd’hui encore, la logique tribale demeure le fil conducteur du paysage politique libanais,
dictant les alliances, les rivalités et les luttes d’influence. Comment, dès lors, prétendre
construire un véritable État ?
La solution pourrait pourtant être simple : revenir à un modèle basé sur de grands blocs
politiques transcommunautaires, à l’image de la Constitution libanaise d’antan. À l’époque, les
forces politiques étaient réparties entre deux grandes formations – la « Bloc constitutionnel » et
le « Bloc national » – qui rassemblaient des représentants de toutes les confessions et régions.
Pourquoi ne pas envisager aujourd’hui un système basé sur deux grands blocs politiques se
disputant le pouvoir dans le cadre d’un scrutin proportionnel ? Celui qui l’emporterait assumerait
pleinement les responsabilités gouvernementales, tandis que l’autre jouerait le rôle de
l’opposition. Ce modèle mettrait fin aux gouvernements d’union nationale qui paralysent l’action
publique et à la culture du partage des quotas entre les différentes communautés.
Mais en attendant cette transformation, et au nom de la République tribale du Liban, bonne
nuit… et à demain dans une autre tribu.
 Politique
Politique